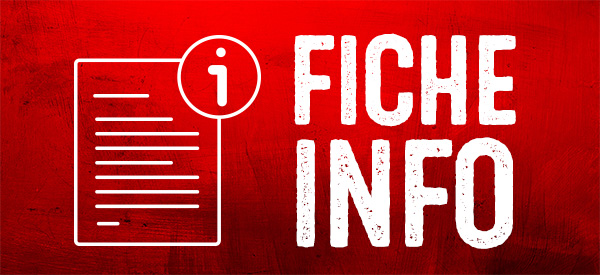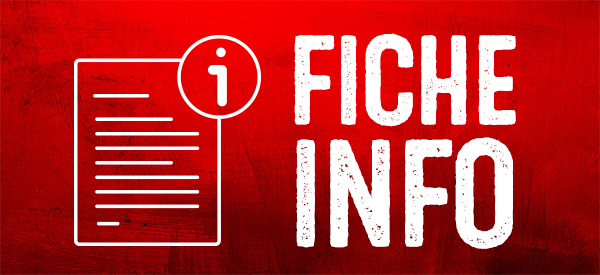Ton affiliation te permet d’une part, de remplir tes besoins individuels : elle te donne accès à des informations adaptées à ta situation professionnelle, une aide juridique et une défense en justice en cas de litige avec ton employeur ou encore avec un organisme de sécurité social tels que l’Onem, le Forem ou encore ta mutuelle.
D’autre part, se syndiquer c’est prendre part à une démarche collective de défense des intérêts de tous les travailleurs, avec ou sans emploi, à travers des actions concrètes au niveau de ton secteur de travail ou au niveau interprofessionnel, mais aussi des activités sociales et culturelles et des formations tout près de chez toi.
 vos droits au quotiden
vos droits au quotiden